Stalker d’Andreï Tarkovski : critique
CRITIQUES ANCIENS FILMS
Yanko Nikitine-Didi
10/31/20243 min read
Stalker est une plongée viscérale dans les abîmes de l’âme humaine, un voyage au-delà des mots et des symboles, qui défie la narration classique pour atteindre un territoire spirituel, presque sacré. Dans cet espace hors du temps, où la Zone se dévoile comme un labyrinthe de ruines et de végétation sauvage (dont le tournage en lieu radioactif a probablement causé la mort du cinéaste et de membres de son équipe quelques années plus tard), Tarkovski nous invite à repenser notre rapport au monde, au sacré et à l’invisible. Inspiré par la nouvelle Pique-nique au bord du chemin des frères Arkadi et Boris Strougatski, le film délaisse les contingences de la science-fiction pour épouser une dimension plus ésotérique, explorant la quête de sens des choses (jusqu’à celle de la vie elle-même). Ce périple, guidé par le stalker, figure chamanique, ombre persévérante, et personnage habité, à la stature d’un Andreï Roublev tarkovskien cette fois plus fragile, plus endommagé encore, le film de 1979 redéfinit le cinéma comme un rituel, un processus de dépouillement où chaque geste, chaque souffle prend une nouvelle ampleur, presque mythologique.
Dans cette progression hypnotique, nouvelle réponse (probablement inconsciente) à Kubrick et son Barry Lyndon (après la confrontation 2001 et Solaris), Tarkovski construit minutieusement un univers sensoriel, modelant la Zone comme un espace à la fois matériel (dans sa dimension existentielle et insensible aux choses, présente), et onirique ; un lieu qui semble être le reflet intérieur des âmes de ceux qui y pénètrent. La caméra, flottant doucement dans cet espace de ruines et de nature en friche, se fait témoin silencieux de l’errance de ses personnages, de leurs angoisses, de leurs espoirs. Chaque plan devient un microcosme, un univers en soi, où le moindre mouvement, le plus ténu des détails, est un écho des interrogations existentielles profondes qui traversent les personnages et, par extension, de manière universelle, l’humanité toute entière. Ce territoire n'est pas seulement celui des désastres humains, mais aussi le miroir des aspirations humaines – celle d’une réponse, d’une vérité à l’image du désir de l’écrivain, du rationalisme du scientifique et de la dévotion du Stalker. Tarkovski capte ainsi, à travers des images dépouillées de toute esbroufe formelle, la confrontation intime des personnages à eux-mêmes, une sorte de purification qui ne trouve aucun repos ni résolution, seulement le poids de la quête elle-même. En résulte un chef-d’œuvre de beauté.
Ainsi, énigmatique, la poésie de Tarkovski traverse tout l’espace du plan devenu aérien. Dans une dominante de la nature et des ruines radioactives se dessine le paysage intérieur du poète : un pays hapax fondé sur les silences et les vestiges… Poésie des déplacements ténus, du retrait et de l’effacement. Évocation du dépouillement, de l'angoisse existentielle, des préoccupations métaphysiques chères au Tarr de Satantango et au Bergman de Persona. Et cela jusqu'à ce verre d'eau final chutant de la table, mû par une autre force (celle de l'esprit, celle de l'inconnu), sous le regard de l'enfant, dans un travelling avant qui semble caresser l'espoir fou de ne jamais s'arrêter. Un souffle, pris dans sa force fugitive ; une direction, concentrée dans son épure : un éclat.
Yanko Nikitine-Didi




Copyright Films sans Frontières
Copyright Films sans Frontières
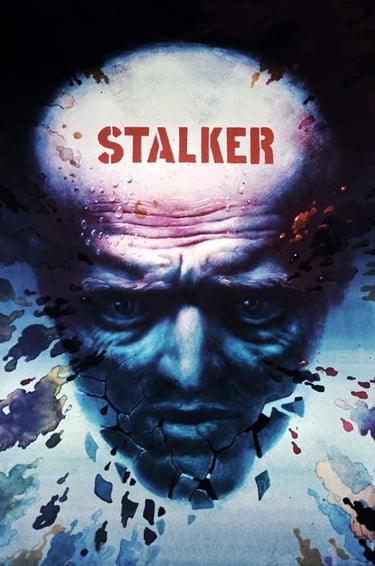
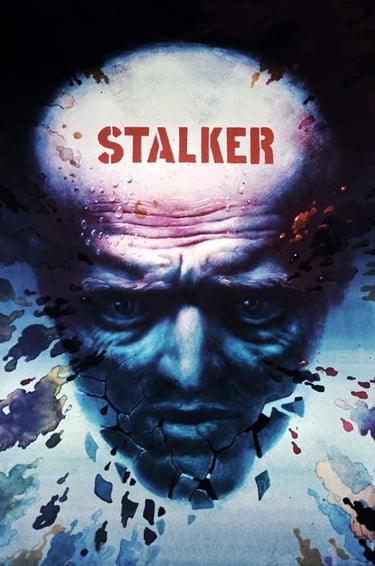
S'inscrire à notre newsletter


