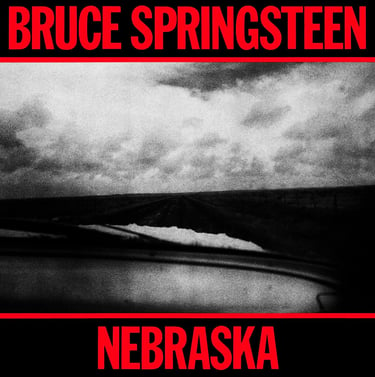Springsteen : Deliver Me From Nowhere, Scott Cooper (2025)
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Marie Boudon
11/7/20255 min read
Le dimanche 12 octobre, dans la queue qui s’est formée devant la salle de l’institut Lumière, un journaliste de Sens Critique vient m’aborder en me posant une question à laquelle on pouvait s’attendre : « vous êtes ici pour Bruce Spingsteen ou Jeremy Allen-White ? ». Moi, je réponds honnêtement que je suis là pour Jeremy Allen-White. The Bear est insensiblement une de mes séries préférées, et quand j’ai vu que l’acteur américain serait à Lyon pour présenter son nouveau film en avant-première, j’ai sauté sur l’occasion.
Alors, tout en répondant à la question, je me sens un peu coupable d’être ici, moi qui ne connais de Bruce Springsteen que le magnifique titre qu’il a composée pour le tout aussi magnifique Philadelphia de Jonathan Demme (1993), et moi qui cultive par ailleurs une certaine aversion pour le genre du biopic au cinéma. En m’installant sur mon siège noir, je m’attends à une imagerie bien claire : des scènes de concert spectaculaires, des producteurs en col roulé jaune qui parlent chiffres et studio, de la sueur et des soupirs, un personnage féminin piètrement écrit, une trame construite en flashbacks, etc, etc.
Puis Scott Cooper et Jeremy Allen-White ont débarqué bras-dessus bras-dessous, ont pris la parole, et la silhouette du film a commencé à se dessiner. Deliver me from nowhere n’est pas vraiment le biopic de Springsteen, mais plutôt celui de son album Nebraska (1982), qu’il compose alors qu’il est en train de tomber en dépression, et refuse de sortir des singles à succès pour secouer les foules.
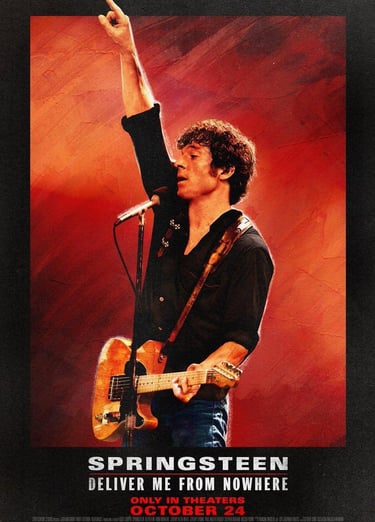
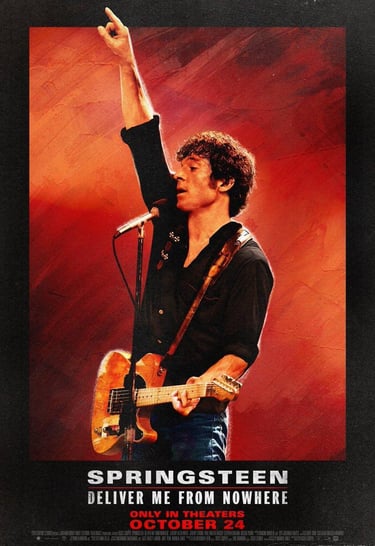
Ce film, long d’un peu plus de deux heures, laisse en moi une impression étrange, parce que j’ai failli m’assoupir d’ennui plus d’une fois pendant la séance, et j’en suis pourtant sortie très émue. Le scénario est sans surprise plutôt mauvais, entre des dialogues pour beaucoup prémâchés et une chronologie non-linéaire très prévisible. La mise en scène n’a rien de notable, les images sont belles, sans plus.
Le traumatisme d’enfance de Springsteen, un père alcoolique et violent envers sa mère et lui, revient de manière obsessionnelle à travers le film par un flashback tourné en noir et blanc. Le film s’ouvre sur ces images du passé, avant d’opérer un cut grossier vers la salle de concert où, des années plus tard, Springsteen performe comme un déchaîné ; une scène qui va rythmer elle aussi l’entièreté du film.
Mais la toile de fond de Deliver me from nowhere, c’est la dépression, pas la célébrité. Et c’est là que le film se détache des idées reçues, dans le sens où il ne cherche pas à mouler le quotidien de Bruce Springsteen dans un schéma narratif classique et manichéen, comme on a pu le voir dans des biopics à gros budget comme Bohemian Rhapsody (Singer, 2018), ou encore Elvis (Luhrmann, 2022).
La plupart du temps, il ne se passe pas grand chose, parce que Bruce fait l’expérience du vide. Un vide existentiel qui, lorsqu’il est pris de front, laisse place à une fertilité artistique – la naissance d’un album qui se démarquera dans la carrière de Springsteen pour sa posture de retrait. Autrement dit, le film met l’accent sur les temps faibles, les doutes, les creux de la création. Les scènes tournées dans le studio d’enregistrement, plutôt que de mettre en scène la genèse de morceaux devenus iconiques, s’appliquent au contraire à montrer leur mise à l’écart, pour prendre le parti de l’intime, faire le choix du silence, des moyens du bord, de la solitude. Bruce écrit ses chansons dans sa maison sur la colline, il les enregistre dans l’intimité de sa chambre, et souhaite à tout prix que sa musique soit retranscrite de cette manière.
Bon. Concrètement, l’approche de Scott Cooper dans la représentation de cette vie en creux n’a pas grand intérêt. On finit par se dire qu’il filme Jeremy Allen-White par plaisir photogénique, sans aller plus loin, ce qui est assez décevant. Je lui préférerais ainsi grandement Last Days (2005), film inspiré des derniers jours de Kurt Cobain, avec lequel Gus Van Sant construit un anti-biopic qui fait du vide existentiel le véritable sujet de son film et de sa caméra.
Ici, le vide se manifeste par exemple à travers le gouffre entre Bruce et son père (joué par Stephen Graham), ce qui donne d’ailleurs lieu à une très belle scène de réunion à la fin du film. Le vide, c’est aussi son incapacité à vivre aux côtés de Faye (Odessa Young), jeune femme rencontrée à la sortie d’un concert. Gage de stabilité, c’est elle qui, entre autre, pousse Bruce à voir un psychologue. Leur relation amoureuse fait entrer la question de la paternité dans la vie de Springsteen, puisqu’elle a déjà un enfant, mais d’elle on ne saura rien. On n’apprendra rien non plus.


Deliver me from nowhere est en fait un film sur la masculinité, sur l’homme auquel on enlève les statuts de fils, de père, d’amant, de star. La dépression commence là où ces attributs s’imposent comme une prison. Il faut alors tout arracher, et c’est dans ce dépouillement que Bruce trouve l’inspiration, qui lui permet de se reconnecter à lui-même, et ainsi, à tout le reste.
C’est sur ce plan psychologique et émotionnel que pour moi le film tient sa route. Bruce interprété par Jeremy Allen-White est attachant, émouvant même, dans la manière dont il épouse sa propre souffrance et cherche véritablement à en faire quelque chose. C’est rare, aussi, de voir un tel comportement chez un personnage masculin. Le cinéma banalise énormément la violence comme le résultat d’une telle souffrance, physique ou psychologique (bien souvent les deux), notamment subie par les femmes.
Ici, c’est différent. La violence appartient au passé. Le présent est fait de questions. Faye est un personnage précieux, bien que marginalisé par le récit, car elle y apporte une réponse.


Ainsi, Deliver me from nowhere est porté par ses acteur.ices et ses enjeux psychologiques plus qu’autre chose. En sortant de la séance, le journaliste de Sens Critique m’a repérée à nouveau, et m’a demandé : « alors, Jeremy Allen-White était-il au sommet de vos attentes ? ». Et j’ai bien sûr répondu oui. Allen-White est, si je puis le dire ainsi, un maître de l’anxiété (il l’a déjà bien prouvé dans The Bear) et le film a tendance à bien s’accrocher à lui – peut-être un peu trop. Je me dois aussi de saluer le travail de Jeremy Strong, dans le rôle du producteur Jon Landau, qui crève l’écran presque plus que Bruce lui-même, à mes yeux.
Depuis, j’ai découvert et beaucoup écouté Nebraska. Cet album résonne en moi, un peu à l’image de ce film : ce qui fait sa valeur c’est tout ce qu’il évoque, bien plus que son propre dispositif. En somme, Deliver me from nowhere n’est au final que sa propre silhouette, son propre (et tendre) résidu.
Marie Boudon
S'inscrire à notre newsletter