Critique : Twin Peaks: Fire Walk With Me ou l’enfer sous la peau
CRITIQUES ANCIENS FILMS
Yanko Nikitine-Didi
3/15/20255 min read
Sorti en 1992, Twin Peaks: Fire Walk With Me arrive dans un contexte particulier : prolongement cinématographique d'une série télévisée culte, il est accueilli avec une hostilité glaciale à Cannes, hué par une presse qui attendait de David Lynch une enquête surréaliste dans la continuité de Twin Peaks, et non une plongée cauchemardesque dans le martyre de Laura Palmer. Ce rejet témoigne aussi d’une incompréhension face à la radicalité du film : loin de capitaliser sur le succès de la série, Lynch, face au fait accompli (des acteurs qui ne veulent plus tourner, des budgets qui sautent, des changements de planning), opère un renversement total, substituant à l’ironie et au mystère une tragédie frontale et viscérale, où la douleur ne se laisse plus filtrer par l’humour ou l’étrangeté rassurante du soap-opera détourné. Un film malade confectionné par Lynch comme le docteur Frankenstein façonne sa créature : par petits bouts disparates, cousus avec passion ; trouvant sa force dans son inextricable cohérence. Une œuvre à la densité fine, à l’opacité transparente. Un cauchemar rêvé, rempli de contradictions et de pistes sans réponses. Une seule certitude : il a déjà tout d’un chef-d’œuvre.
Dès son ouverture, le film désarçonne. L’affaire Teresa Banks, mentionnée dans la série, devient le prologue chaotique d’un film hanté par le spectre de la disparition. Chris Isaak, le célèbre chanteur guitariste de soft rock révélé par David Lynch lui-même en 1990 dans le sulfureux Sailor et Lula, incarne ici l’agent du FBI Chet Desmond. Une figure aussi fascinante qu’énigmatique, introduite sur du jazz signé Angelo Badalamenti (le double musical de Lynch, fidèlement à ses côtés depuis Blue Velvet). Cet agent porte le nom et prénom des musiciens Paul Desmond et Chet Baker, deux icônes d’un jazz dont Badalamenti hérite ici. Contrairement à Dale Cooper, Chet Desmond n’est pas un médium à l’enthousiasme naïf, mais une présence plus terre-à-terre, dont le rôle, si il est vite éclipsé du récit, est d’implicitement donner à la musique une dimension tout à fait particulière : celle de transcender l’espace et le temps. Les notes fuyantes de saxophone accompagnent les morts comme les vivants, de Deer Meadow à Twin Peaks, du roadhouse à la Black Lodge. On sait la place que Lynch accorde à la musique dans son œuvre – ceci ne présageait que du bon.
Si Chet Desmond disparaît rapidement, c’est que le film ne lui appartient pas. Il est un faux protagoniste, une fausse piste dans un récit où la véritable héroïne est Laura Palmer. Ses derniers jours sont contés comme un long cauchemar éveillé, où le réel et l’illusion se confondent. Lynch épouse son point de vue, nous enfermant petit à petit dans son intériorité torturée. C’est ici que réside la radicalité du film : alors que la série fétichisait le mystère autour de la jeune femme, Fire Walk With Me nous projette au cœur de son calvaire.
L’une des grandes forces du film, et sans doute une des raisons de son rejet initial, est sa manière brutale d’aborder la violence sexuelle. Le film déchire le voile pour révéler frontalement l’inceste, l’objectivation du corps féminin et le désir prédateur des hommes, qui fantasment des femmes jeunes, soumises et malléables. Un questionnement central chez Lynch, grand cinéaste du viol et du malaise qui s’immisce jusqu’à l’écœurement lorsque les hommes s’efforcent à imposer leur emprise et leur virilité. L'idée de brouiller les pistes entre Leland et Bob est l’un des coups de génie du film : à chaque instant, on oscille entre la figure du père et celle du monstre, entre l’homme et son double maléfique, parfois sans être totalement certain de qui contrôle le corps, de qui commet l’horreur. L’une des scènes les plus glaçantes à cet égard est celle où Leland, d’un calme implacable, observe Laura, Donna, et les fantasme en sous-vêtements. Une image d’une perversité vertigineuse. Immense idée de cinéma permettant à Lynch de mettre en scène la mécanique du désir patriarcal et son effroi.
Mais Fire Walk with Me n’est pas seulement le portrait d’une figure déchue, d’une tragédie grecque réincarnée dans l’Amérique pavillonnaire. C’est aussi un film sur le passage à l’âge adulte, où l’innocence ne s’efface pas progressivement mais se consume dans la douleur et l’hystérie. Laura n’est pas une victime sacrificielle édifiée en symbole : elle est une adolescente qui lutte, qui crie puis s’étouffe, qui s’effondre et qui survit, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à sauver. Dans cette descente aux enfers, Lynch orchestre un conflit inaltérable entre l’ordre et le délire, qu’il filme avec une précision clinique et un embrasement baroque. On se perd dans un capharnaüm érotico-onirico-cradingue tourbillonnant, où le cinéaste dynamite la logique, l’espace et le temps avec une virtuosité hallucinante. L’expérience devient totale : un voyage au cœur du mal, où la réalité se distord sous le poids de l’horreur et du désir, jusqu’à l’implosion finale.
Le dernier acte marque l’apothéose du cinéma de Lynch : une catharsis suffocante, un requiem dévastateur, débouchant inévitablement sur la mort et un questionnement : à la fin, que reste-t-il ? Un écran de fumée derrière lequel Laura Palmer, les larmes aux yeux, le visage anéanti après une existence marquée par l’abandon et la souffrance, accède enfin à un apaisement, porté par la magnificence de la musique et des flashs de lumière. Plus de mots… Simplement la tristesse et la beauté de l’ineffable qui se confondent chez ceux qui ne sont plus.
Yanko Nikitine-Didi
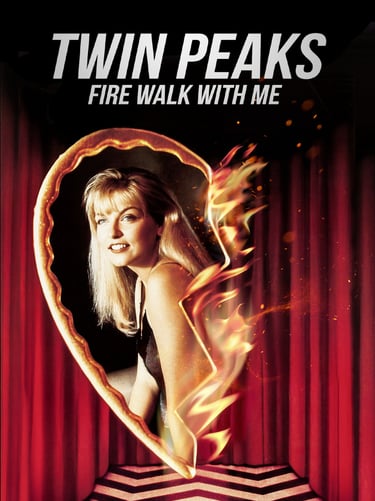
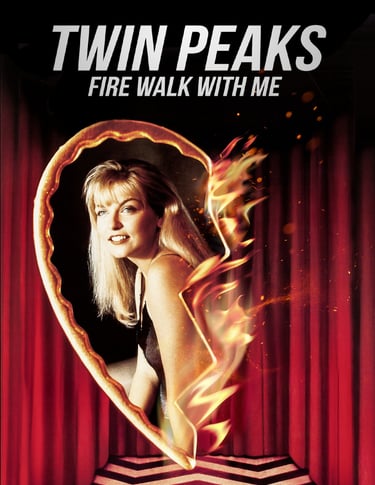






Copyright Lorey Sebastian
Copyright Lorey Sebastian
Copyright Lorey Sebastian
S'inscrire à notre newsletter


