The Brutalist : Monumentalité ou Fragilité ?
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Thomas Lignereux Ocana
2/17/20253 min read
Le monde entier semblait annoncer la monumentalité à l'état pur.
Une espèce d'acmé du cinéma américain, peut-être trop longtemps disparue et ranimée ponctuellement grâce aux fulgurances de cinéastes accomplis. Difficile de ne pas voir du There will be blood dans cette fresque d'intégration aux senteurs «d'American way of life».
Ce n'est pas tant l'ampleur historique qui véhicule cela que le battage médiatique ou l'esthétique de surface que promeut le film, notamment par sa typographie.
Le «monumental» semble être l'argument de «com» primordial du film. On peut se souvenir aisément de Babylon dont on aurait pu se passer de la brinquebalante monumentalité. N'allons pas trop vite en besogne, on est tout de même assez loin du film de Chazelle.
Nonobstant, cette monumentalité se stratifie mais tend hélas à se gargariser dans sa propre nature.
En effet, The Brutalist, devrait comme son nom l'indique, parler d'architecture, du moins d'un architecte. Néanmoins, Brady Corbet semble tomber dans les écueils attendus des films filmant l'art. Devrais-je dire des films sur l'art ne filmant pas l'art ? Que nous dit-il de l'architecture brutaliste, du moins celle de Toth, en tant que forme novatrice ? Absolument rien, puisqu'elle ne semble être que le réceptacle d'une esthétisation monolithique d'une vision de l'art et particulièrement de l'artiste, en tant qu'entité presque surnaturelle et quasi maudite.
Trope résolument conventionnel et assez peu inspiré, puis qu’étant le cliché absolu de «l'Artiste»; aussi misérable soit-il, il va rayonner dans sa misère.
Il est certain que cette dramatisation s'ancre pleinement dans le réel du fait du statut de rescapé de Buchenwald de son protagoniste. Néanmoins, il n'est aucunement question de traiter son trauma et la réflexion qu'elle a sur son art, en quoi ce dernier peut être induit par ce qu'il a vécu. Jusque-là, un axe narratif pas vraiment innovant, mais plutôt essentiel me semble-t-il.
Ainsi, c'est ici que pêche dramatiquement le film. Alors que l'on reste, globalement, dans la suggestivité par omission ou par l'ellipse, le trauma, dissimulé aux yeux de tous dans cette volonté d'un nouveau départ, va être expliciter par l'épilogue venant entériner tout ce que le reste du film échoue à faire.
Dans un élan de reconnaissance artistique internationale, ce qui a finalement toujours échappé à Laszlo Toth, sa nièce, désormais mère, explique – le film quittant définitivement le champ cinématographique reposant sur ce qu'il peut montrer pour pénétrer dans la sphère du discours filmé, donc purement démonstratif – le génie du travail de son oncle, la grande profondeur de son art, toujours en résonance avec ses stigmates de la Shoah. Cet aveu d'échec semble démontrer de la volonté de Corbet à éclipser l'art de son artiste. Désintéressement au profit d'une plasticité millimétrée et d'un discours final expéditif et explicatif.
Le choix de cet immigré d'Ellis Island, bien que là encore déjà-vu, pouvait se suffire à lui-même, puisque si Toth avait un volant, un pinceau, une spatule ou une caméra entre les mains, le récit visuel n'aurait en rien été altéré. Que tire le cinéaste de cet art brutaliste, si ce n'est des formes au potentiel esthétisant, qu'il ne parvient même pas à capturer tant il se refuse à magnifier ces objets d'art, simplement par la pure captation cinématographique. Cela en usant de la matière première du cinéma, la lumière. Le seul moment où l’œuvre, quasi achevée, de Toth sera filmée est lors de la disparition du bourgeois perfide et mesquin incarné par Guy Pearce. Néanmoins cette dernière ne vit que par une fragmentation labyrinthique anonymisant l'espace et nous faisant oublier sa nature même. D'autant plus encore que le lieu est plongé dans la nuit noire, ne dévoilant donc jamais son caractère de «chef d'oeuvre» architectural du fait de son harmonie structurelle embrassant la lumière.
En outre, dans cette démarche de cinéaste indépendant, il est ardu de ne pas y voir un cinéma sclérosé, croulant sous un certain héritage hollywoodien, ne laissant jamais s'exprimer autre chose qu'une surabondance musicale, un actorat parfois théâtral à la performance «oscarisante», où la forme, très belle au demeurant, peine à sauver le reste et à conférer un sens profond à la mise en scène.
Thomas Lignereux Ocana
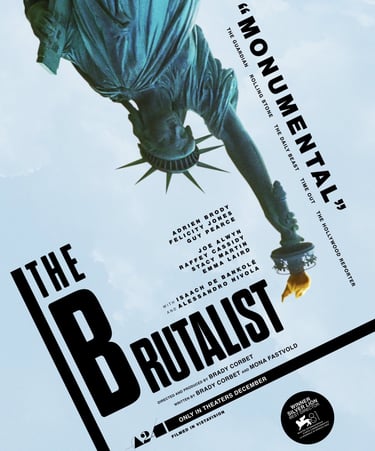
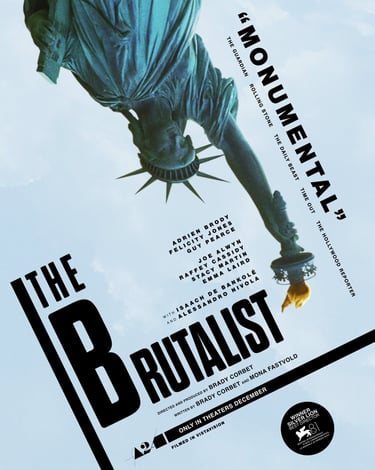




S'inscrire à notre newsletter


