Critique : Réflexion sur La Zone d'Intérêt et les dispositifs de filmage des camps nazis
ARTICLESCRITIQUES ANCIENS FILMS
Thomas Lignereux Ocana
12/1/20244 min read
Quelle responsabilité incombe le cinéma lorsqu'il filme une dramaturgie inhérente à l'historicité de son sujet telle que peut l'être la représentation de la Shoah et des camps nazis ? Le cinéma en devient-il moins cinéma lorsqu'il entre dans un certain degré de monstration, à l'inverse, est-ce inapproprié ou pompeux de tenter de faire art, que le dispositif puisse être identifié comme artificiel ? Peut-être que pour faire cinéma, il se doit une honnêteté telle que tout dispositif de captation doit en être dépouillé.
Dépouillé de sa propension technique à produire du spectaculaire ou du «tape à l'oeil», pouvant altérer l'être humain capté, en être de cinéma, dévitalisé de ses aspérités, ce qui, en ce sens, pose problème et a été relevé par Jacques Rivette dans Kapo de Gillo Pontecorvo; l'abjection de théâtraliser le malheur, le drame humain, la vérité de la souffrance, d'en faire un produit calculé, machinal, représentant une vision aseptisée et fausse des camps.
Si ici le risque serait de tomber dans un sorte de «misérabilisme glamour», l'exact opposé, tel un «misérabilisme vériste» n'en est pas forcément une solution bien meilleure. Un film comme Le Pianiste de Roman Polanski, dont je ne doute aucunement de la sincérité, me rend plutôt perplexe. Il serait de ces films à l'allure plutôt naturaliste, d'un regard acerbe et résolument réaliste sur la Seconde Guerre Mondiale, toutefois, la distance et le dispositif formel font parfois sombrer le film dans une certaine démonstration émotionnelle, menant à un pathos désincarné. Cette désincarnation passe majoritairement par les choix de mouvements de caméras, le jeu très «hollywoodien», tout cela créant cette sensation de cinéma, avec tous les leviers affectifs qu'il peut déployer, mais sans jamais atteindre l'épure, la finesse de l'émotion la plus absolue et sincère par le simple mais complexe dépouillement esthétique.
Et, c'est probablement en cela que s'illustre La Zone d'Intérêt de Jonathan Glazer; le film va plus loin dans la représentation malgré son parti pris d'omission. Choix discutable, puisque l'absolue omission n'est pas. Auschwitz est, hormis dans les scènes d'intérieur, toujours présent dans le cadre, comme ce conséquent agglomérat de bâtiments, grondeurs, déshumanisants et coercitifs, où l'insomnie constante des corps par le travail forcé constitue une toile de fond à la narration visuelle. Il n'y donc pas volonté de montrer frontalement mais bien d'horrifier par la suggestion.
Suggestion relative puisque le travail du son ancre sans cesse le spectateur dans l'atrocité, d'autant plus que l'image ne cesse de présenter, par juxtaposition au camp, le petit quotidien idyllique d'une famille monstrueuse. Un vrai dépouillement est alors proposé par le dispositif même de la caméra, refusant toute proximité physique ou chaleur colorimétrique à l'égard de ses personnages.
Tantôt filmés par le biais de caméras, implicitement, de surveillance où s'ajoute seule, la lumière naturelle ou lumière disponible des intérieurs. Il semble donc évident que le geste du cinéaste est d'opérer une grande distanciation avec ce réel prosaïque qui nous est présenté, sans tomber dans une absurdité spectaculaire due à la mitoyenneté avec le camp.
Cette quotidienneté enchantée, ne l'est que pour ses acteurs, excepté la mère du personnage interprété par Sandra Huller, qui prendra bien la peine de fuir la glaçante tranquillité avilissante de sa fille.
Toutefois, si le métrage brille par bien des aspects, il ne semble pas exempt d'éléments discutables de mise en scène. Sans côtoyer l'obscénité du travelling de Kapo (cf. l'article de J.Rivette), certains des travellings latéraux, illustrant les scènes du jardin annihilent l'épure et la pertinence globale de sa forme, notamment celui du plan d'ouverture; plan d'ensemble d'un calme et innocent effroi.
Ici, la fluidité et harmonie des mouvements de caméra et Auschwitz en arrière-plan amènent le film dans une strate esthétisante qu'il n'a cessé d'éviter jusque-là. L'image dépouillée se substitue au formalisme clinique d'un travelling kubrickien. Aberration plastique créant pour l'oeil du spectateur un repère cinématographique agréable et plaisant. Le film sort alors de sa dissection au vitriol du réel pour tomber dans le cinéma pur, en ce qu'il représente un entre-soi codifié, reconduisant son propre référentiel et sa grammaire propre, ne dialoguant plus avec le monde mais seulement avec lui-même en tant qu'art autarcique.
Par là, l'utilisation du son comme vecteur humble et pudique de l'horreur nazie opère une fonction ambivalente; celle d'une création d'empathie et d'une perversité ludique du regardeur. Se déploie donc, probablement par mégarde, un potentiel échange avec le spectateur, non plus uniquement basé sur le réel, sa représentation et la véracité de ce dernier mais également sur un jeu indiciel, où l'oreille tendrait à chercher la source, la nature du hors-champ par la stimulation primaire et donc divertissante des sens et par extension de l'imaginaire du spectateur.
Peut-être plus que tout autre médium artistique, le cinéma nécessite une méticulosité dans le traitement du réel, qui l'emmène parfois à l'incarnation de ce dernier. Toutefois lorsque l'éthique est capitale dans le champ de représentation et le traitement thématique, l'acuité du cinéaste doit en être décuplée, ce qui fait, à mon humble avis, de La Zone d'Intérêt une œuvre cinématographique au dispositif complexe et particulièrement ambiguë.
Thomas Lignereux Ocana
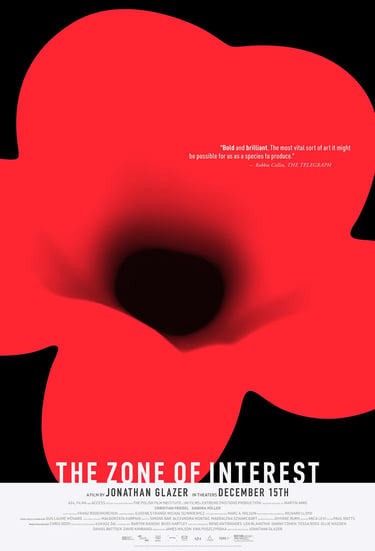
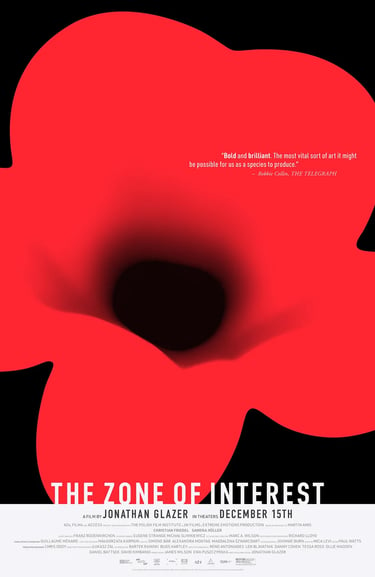




Copyright D.R.


Copyright Leonine
Emmanuelle Riva dans Kapò de Gilles Pontecorvo (1961)
S'inscrire à notre newsletter


