Napoléon : la plus grande restauration de l'histoire du cinéma ?
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Thomas Cordet
1/2/20254 min read
Qu'est-ce que Napoléon vu par Abel Gance ? C'est une œuvre monumentale, un “monstre”, comme le dit George Mourier, réalisateur et chercheur en charge de sa restauration pour la Cinémathèque française. Réaliser une fresque sur la vie de Napoléon grâce à une vision et des techniques cinématographiques révolutionnaires : c'est ça, l'ambition d'Abel Gance. Le cinéaste y a dédié sa vie, et pour cause : pas moins de 22 versions du premier long-métrage se seraient succédées, sans compter celles des trois suites prévues ! Et tout au long du XXe siècle, ces versions se sont perdues et mélangées. Comment alors restaurer cette œuvre démesurée selon la vision du savant fou qui l'a conçue ? C'est pourtant ce qu'ont entrepris des centaines d’artisans passionnés pendant 16 longues années. Ainsi, en 2024, le résultat est projeté en ciné-concert à la Seine Musicale : les cinéphiles du XXIe siècle découvrent alors l’un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma muet.
Dès le début de la bataille de boules de neige, j'ai vu des plans d'une ingéniosité hors du commun, des mouvements de caméra au cœur de l'action, des surimpressions et un montage survolté. J'ai vu les prémices de la création du mythe de Napoléon, prédestiné à la grandeur, grâce à une introduction de personnage des plus efficaces. L'aigle impérial est déjà là : sans un mot, tout est dit.
Et puis, 1792, les Cordeliers, les Trois Dieux, la Révolution : le film commence. Alors l'envolée du génie d'Abel Gance nous offre Rouget de Lisle et cette première Marseillaise, baignant dans une lumière dorée. Puis le rouge de la colère attisée par la flamme de Danton, le rose du paisible retour en Corse, troublé par le bleu de la nuit, la traque du fugitif, la course poursuite, la mer déchaînée et le tonnerre grondant. En seulement deux heures, la plus grande épopée du cinéma muet est née. Et elle ne fait que commencer.
“Napoléon vu par Abel Gance” © La Cinémathèque française
La nouvelle orchestration de cette restauration nous emporte dans le tourbillon de la Révolution, suivant l'ascension du général Bonaparte, qui prend alors bien soin de marcher sur des œufs pour que son terreau fertile se consolide. Le Siège de Toulon, première bataille d'envergure du film, nous plonge dans l'abîme de la violence et du chaos au plus près des combats, bravant la nuit et la tempête. Une nuit étouffante aux couleurs rouge et noir du sang et de la boue.
Le chaos du champ de bataille appelle le chaos politique : après l'exécution de Danton (accompagnée par ce terrifiant crescendo de cordes et de cuivres si bien connu grâce à Shutter Island) s'en suit alors la Terreur, la Convention bancale de Robespierre et Saint-Just, avec son désordre et ses foules grondantes comme une fourmilière. Le tumulte et les exécutions arbitraires cèdent rapidement leur place à la fête une fois le régime tombé, le 10 thermidor 1794. Le rose reprend le contrôle de l'écran pour une longue séquence de joie et de frivolité, préparant l'arrivée de l'amour indissociable du parcours de Napoléon : Joséphine entre en scène et humanise le général, le faisant enfin quitter son air impassible et sa posture de roc infrangible.
“Napoléon vu par Abel Gance” © La Cinémathèque française
Ultime moment de calme avant le final : Napoléon visite l'enceinte vide de la Convention et dialogue avec les fantômes de la Révolution. Cet instant hors du temps est de loin le plus marquant de ces sept heures. Abel Gance utilise une fois de plus ses surimpressions pour brouiller les frontières entre la vie et la mort. Face au mont Olympe, le général prête serment aux dieux qui lui ont fait place. Leurs silhouettes gigantesques occupent tout l'espace et se mélangent à la foule applaudissant leur nouveau héros, leur messie. Après cette dernière Marseillaise en communion avec les grands esprits de la Révolution Française, il est temps de partir vers l'Italie... et pour Abel Gance de se munir de ses trois caméras.
En une campagne éclair, Napoléon entre en Italie, filmé par le révolutionnaire procédé de triple-écran du réalisateur. Armé de sa Polyvision, Abel Gance compose des images inouïes, jamais vues jusqu'alors, et à ma connaissance jamais égalées depuis. Panoramiques étendus, symétries en miroir : absolument magnifique. Dommage que ce final soit si court, une heure supplémentaire de cette même grandeur n'aurait pas été de refus. Au lieu d'une nouvelle bataille, le triptyque sert plutôt de conclusion au périple de Napoléon, qui deviendra bientôt Empereur conquérant.
“Napoléon vu par Abel Gance” © La Cinémathèque française
Cette immense fresque n'est que plus impressionnante en connaissant les travaux de restauration qui nous l'ont fait parvenir. Il s'agit réellement d'un accomplissement historique, au même titre que la réalisation de Gance presque un siècle plus tôt. J'ai découvert l'existence de cette œuvre il y a quelques années au musée de la Maison Bonaparte à Ajaccio (la même de laquelle sa famille est chassée par Paoli dans la première partie du film), et en cette fin d’année 2024, j'ai eu la chance de la découvrir gratuitement grâce à France TV et aux 16 ans de travail de centaines de personnes. C'est aussi ça, la magie du cinéma.
Thomas Cordet
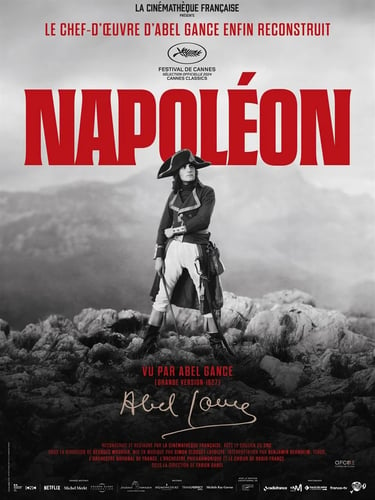
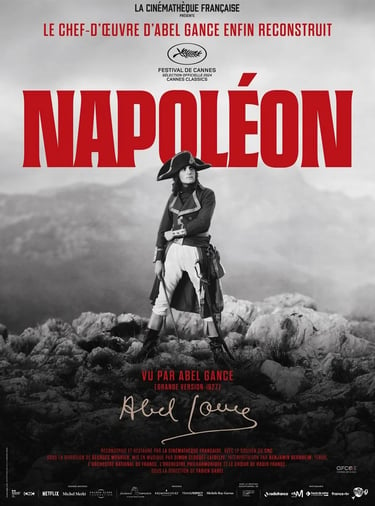






S'inscrire à notre newsletter


