Critique : Grand Tour, Poésie des fragments
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Yanko Nikitine-Didi
12/22/20244 min read
Miguel Gomes s’impose depuis plusieurs années comme l’un des cinéastes les plus audacieux de sa génération, capable de mêler l’intime à l’universel, le trivial au grandiose, et de défier les attentes du spectateur. Avec Grand Tour, il signe une œuvre déroutante et poétique, sur la crête vertigineuse du néo-réalisme : entre fiction et documentaire. Gomes se plait à brouiller les frontières entre les époques et les registres. Lauréat du prix de la mise en scène à Cannes (rien que ça), le film propose un voyage esthétique et philosophique à travers un noir et blanc somptueux, récit fragmenté sur la condition humaine. Si cette proposition peut dérouter par son éloignement des codes narratifs traditionnels, elle captive par son ambition formelle et son discours sur les pouvoirs de la fiction.
Le film s’ouvre sur un manège, métaphore ludique qui imprègne toute l’œuvre. Grand Tour est une invitation à l'abandon : à l'histoire d'abord, puis aux images elles-mêmes. Gomes mêle plusieurs temporalités et registres : un récit en 1918 et des séquences contemporaines aux accents documentaires. À travers ce dispositif, le cinéaste explore le monde en capturant ses paysages et ses habitants dans une démarche presque anthropologique, tout en laissant place à une fiction prenante mais constamment désamorcée par une voix off. Essentielle, celle-ci narre des fragments de récit qui échappent à l’image, accentuant une sensation de décalage.
Ce "jeu" place le spectateur en posture brechtienne : il est actif, presque acteur face à l'œuvre. L’histoire centrale – une femme à la recherche de son fiancé disparu – agit comme un fil conducteur ténu, mais sur lequel Gomes ne s’attarde jamais complètement. Car le film porte surtout sur le monde : les gens qui le peuplent, et, comme le théorisait Bazin, la matière, à impressionner sur la durée. Le film emprunte au langage du cinéma muet, avec ses transitions à l’iris et son grain noir et blanc, tout en conservant une conscience résolument moderne. Dispositif dont se sert Gomes pour tracer une satire des privilèges coloniaux, particulièrement dans des scènes où les élites européennes cohabitent, de façon incongrue, avec des cultures locales exotisées. La confrontation de la cohabitation de ces mondes produit à la fois une critique sociale et une esthétique saisissante, où les séquences en studio (et ce qu'elles comportent de reconstitution du réel comme d'artificialité) évoquent un monde imaginaire, parfois grotesque, entre Conrad et Herzog.
Mais Grand Tour n’est pas seulement une réflexion sur le passé. Par son montage anachronique et sa confrontation constante entre les époques, Gomes interroge la place de l’art et de la fiction dans notre rapport au réel. Loin d’être une simple aventure amoureuse, le film explore la manière dont l’imaginaire peut transcender la condition humaine. Les scènes, qu’elles soient oniriques ou documentaires, convoquent des émotions profondes et universelles, comme cette danse sur Le Danube Bleu, différente du ballet de Kubrick, transformée en une traversée immobile empreinte de mélancolie. Cette temporalité distendue pousse le spectateur à une réflexion métaphysique : l’éternel retour des émotions et des récits dans notre existence quand ça compte le plus.
Visuellement, le film s’impose comme une œuvre magistrale. Les paysages en noir et blanc, à la fois denses et éthérés, mais d'une grande profondeur de champ, fascinent tant ils paraissent palpables. Gomes joue avec la lumière pour sculpter des espaces qui semblent vivants, où chaque détail invite à l’exploration. Cette beauté plastique, comme pour Satantango de Béla Tarr, est un appel à se perdre dans l’image, à en ressentir la matérialité et à abandonner la quête de sens immédiat. Si certains spectateurs pourraient être rebutés par cet aspect qu’on pourrait qualifier d’"intellectuel", il constitue une richesse inépuisable pour ceux qui acceptent d'y plonger.
Avec Grand Tour, Miguel Gomes rend grâce à la fiction et au cinéma, non pas comme simple distraction, mais comme une nécessité pour comprendre ce qui nous dépasse. En mêlant les époques, les styles et les registres, il dépasse les limites du récit classique pour offrir une expérience cinématographique totale, à la fois sensorielle et réflexive. Cette œuvre, qui semble parfois s’égarer volontairement dans ses élans narratifs et anarratifs, est avant tout une invitation à s’abandonner : à la beauté des images, aux échos des voix, et aux infinis pouvoirs de l’imaginaire.
Yanko Nikitine-Didi
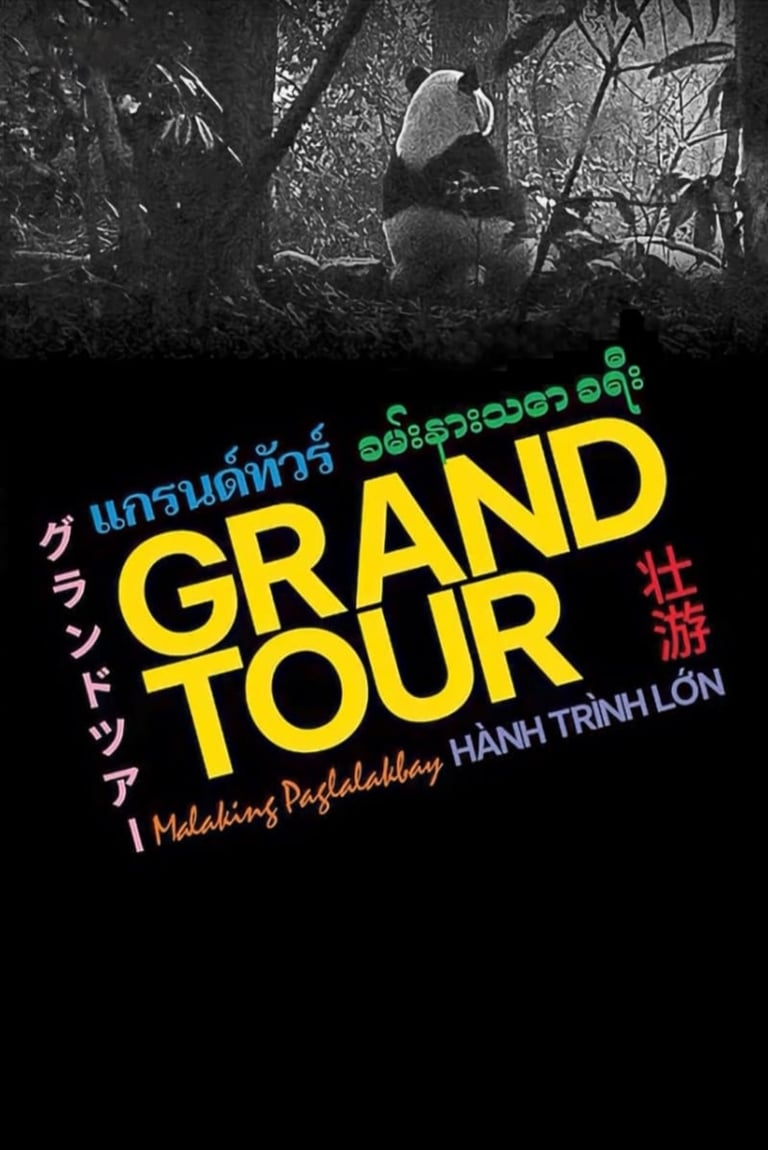
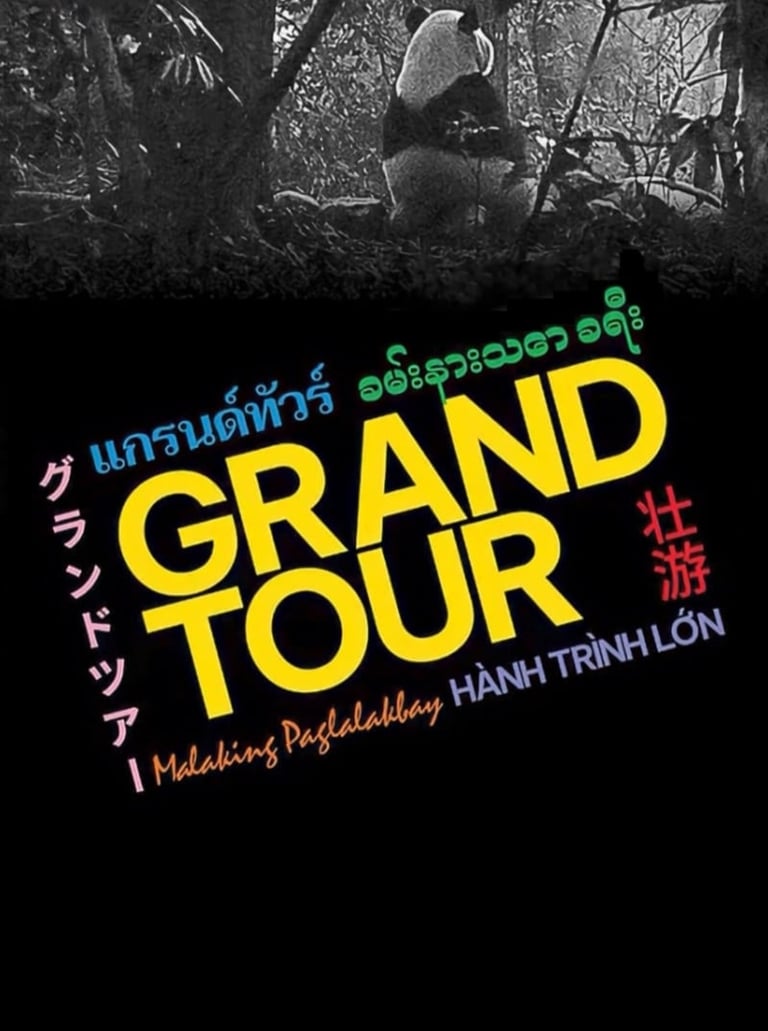


Copyright Shellac Distribution


Copyright Shellac Distribution


Copyright Shellac Distribution
S'inscrire à notre newsletter


