Critique : GLADIATOR II ou un regard anachronique sur une société en crise d’identité
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Baptiste Brocvielle
11/27/20246 min read
« Maintenant nous sommes libres, et nous nous reverrons. » Juba avait-il déjà lu, dans le sable du Colisée, que la nostalgie pousserait inexorablement le cinéma à exhumer la légende de Maximus ? Mû par une honorable démarche artistique ou purement mercantile ? Permettant la création d’une œuvre tant singulière que digne de l’héritage de Gladiator ? Pas encore, pas encore…
Un quart de siècle s’est écoulé et Gladiator premier du nom demeure un film profondément ancré dans son époque. Une image saturée où l’orange et le bleu se confrontent, où les ralentis saccadés s’enchainent. Cette suite est elle aussi le reflet d’une mode contemporaine : une image qui se veut réaliste devient terne, dénuée d’unicité. Comme beaucoup de blockbusters actuels, les couleurs bien que présentes à l’écran ne marque pas la rétine. C’est leur absence totale qui permet, le temps d’une scène, de représenter le mythique : le nocher Charon sous un ciel blanc, escortant une âme défunte sur l’eau noire du Styx.
Grâce à l’évolution des effets spéciaux numériques, Ridley Scott met en image tous ses fantasmes de divertissement démesurés, quitte à parfois tomber dans l’outrancier. Ces grandes scènes d’actions sont cependant assez courtes. Passée la découverte des éléments qui constitueront la confrontation (navires, singes et rhinocéros enragés), la bataille en elle-même dure peu et l’on regrette que ces éléments ne soient pas plus développés.
L’action du premier Gladiator a un montage effréné, très découpé, la rendant parfois confuse. De ce fait, il devient difficile de déterminer celui qui a le dessus dans l’affrontement. Une tension supplémentaire s’installe vis-à-vis de l’issue incertaine du combat. Dans cette suite, l’action filmée avec des cadres plus larges et souvent en plan séquence rendent les duels plus clairs - peut-être trop clairs. Les confrontations bien que spectaculaires génèrent moins de tension, donc peu voire pas d’implication du spectateur.
Dernier élément intrinsèque à l’action qui ait évolué : la représentation de la violence. Ridley Scott choisit de retranscrire la brutalité des combats sans détour. Si Gladiator était déjà sanglant, Gladiator II est un véritable bain de sang. Le réalisateur est conscient que le public supporte bien plus la violence graphique qu’il y a 24 ans et veut malgré tout le choquer.
L’œuvre d’art est toujours reflet de la société qui l’a vue naitre. Le cinéma, en ce qu’il est un art technique et récent, se transforme au rythme d’une constante évolution technologique. Ce perpétuel progrès est régulièrement justifié par une démarche réaliste ; mais un regard sur les divergences de représentation cinématographique des deux Gladiator nous interroge sur sa nécessité. La volonté de dépeindre l’action d’une façon plus réaliste et brutale ne doit pas se faire au détriment de l’émotion.
L’action est depuis toujours intimement liée au cinéma : elle est synonyme de spectacle et de divertissement. Les gladiateurs ont rapidement fait place aux acteurs de théâtre car la représentation d’une violence dramatique permettait une purgation des passions encore plus intense. Toutefois, pour qu’il y ait catharsis, le spectateur doit être emporté au cœur de la tragédie présentée, vivant par procuration les émotions qui en résultent.
Hélas, l’implication émotionnelle est sûrement le manquement le plus cruel de cette suite. Aucun personnage (exception faite peut être du général Acacius) ne touche le spectateur. Leur évolution au fil du récit ne se traduit que par un statut social, pas par un changement d’état d’esprit. Leur mort, bien souvent expédiée, n’inspire ni crainte ni pitié.
Pour conquérir le cœur du public, le premier Gladiator reprenait le modèle du protagoniste de tragédie antique : un homme vertueux subit la trahison, perd tout ce qu’il a gagné et ne désir que se venger. Le mortel face à la cruauté du destin. Le personnage d’Hanno, incarné par Paul Mescal, semble n’être qu’une redite de Maximus. Seule la vengeance, née de la perte d’un être cher, le poussera à survivre. Si dans l’ensemble les personnages se ressemblent, il est un point clé qui diffère. Le spectateur n’a pas d’empathie pour le second.
Quand Gladiator nous présentait un héros tant fort dans la bataille que clairvoyant dans la politique, pour qui l’honneur comptait plus que tout ; Hanno nous apparait comme un homme qui a abandonné son nom romain et toutes les valeurs qui y étaient rattachées. Lucius Verus, fils de Maximus, ne s’illustrera à l’écran que par sa rage. Cette rage d’abord mue par la perte d’un proche perdra peu à peu de son sens. Il finira par la mettre aux profits des convictions de son père. Face à un personnage principal en pleine crise identitaire, engagé dans des combats dont il n’est pas réellement l’instigateur ; difficile pour le spectateur d’être autant impliqué émotionnellement qu’avec un Russel Crowe érigé en pure figure iconique. Lucius ne semble finalement pas maitre de sa propre épopée, il évoque un fils soucieux de perdurer la légende de ses ancêtres. Le gladiateur pourtant éponyme n’est pas au centre du poème.
En effet, là où l’essentiel du récit du premier volet se déroulait dans l’arène, Ridley Scott choisit de rendre cette suite beaucoup plus politique et donc moins centré sur le Colisée. Dans l’ensemble, les liens qui rattachent les deux films sont plutôt maladroits. Le réalisateur aurait surement dû s’affranchir du cadre de Gladiator pour plonger pleinement dans les complots du pouvoir romain. Bien qu’un échec au box-office, Le Dernier Duel nous démontrait en 2021 que le Britannique pouvait encore briller par ses réalisations historiques. A l’évidence, entre un film sur Rome et la suite du plus grand péplum moderne, un choix marketing s’est imposé.
Scott se sert néanmoins de ce second volet pour faire passer sa vision, et ce bien plus que dans le précédent. Du haut de ses 86 ans, il nous transmet le regard anachronique qu’il porte sur la société qui l’entoure. On retrouve une Rome dans un état encore plus critique que dans Gladiator : la capitale du monde a perdu toutes les valeurs qui faisaient sa grandeur. Le pouvoir a corrompu ses titulaires et le rêve de Marc Aurèle ne restera qu’une chimère. Lucius ne voit d’autres solutions que de se rattacher aux principes de jadis. Les empereurs jumeaux, personnification de Romulus et Rémus, sont eux aussi sans repères et leur insanité sera utilisée pour précipiter leur chute. Au-delà d’une cité romaine gangrenée, ce sont les jeunes qui, en quête de sens et d’identité, se tournent vers le passé. Ce rapport assez méprisant vis-à-vis de l’âge était déjà présent il y a 24 ans où Marc Aurèle, allégorie de la sagesse et Maximus, allégorie de la force lucide étaient opposés à un Commode plus proche de l’enfant que de l’homme.
Difficile, à la lumière des multiples déclarations de Scott à l’encontre de Trump, de ne pas rapprocher cette critique politique et sociale des récentes élections américaines. Le fer de lance du 47ème président américain a toujours été de rappeler à ses électeurs la grandeur passé des Etats-Unis, et comment son accession au pouvoir permettrait de la retrouver : « Make America Great Again ». La jeunesse se range volontiers derrière cette promesse de renaissance, où un temps révolu peut enfin être connu. Le danger de la nostalgie des empires perdus.
Ridley Scott s’auto-intègre malgré lui dans cette critique, en reprenant un grand film d’autrefois pour en faire une suite moderne : lui, les studios, le cinéma, tous succombent encore et toujours à cette volonté de retrouver le souffle d’antan. Et comme Lucius n’arrivant pas à insuffler la conviction qu’avait Maximus dans le combat, il ne parvient pas à inculquer une âme à ce nouveau récit. Le fait même d’avoir réalisé ce film vient clore cette pensée initiée par le réalisateur britannique : il est vain de chercher notre identité dans le passé.
Baptiste Brocvielle
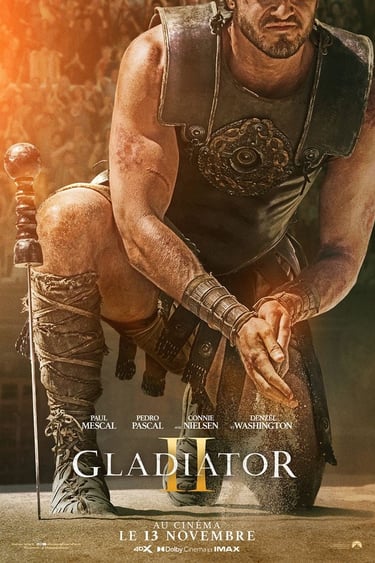
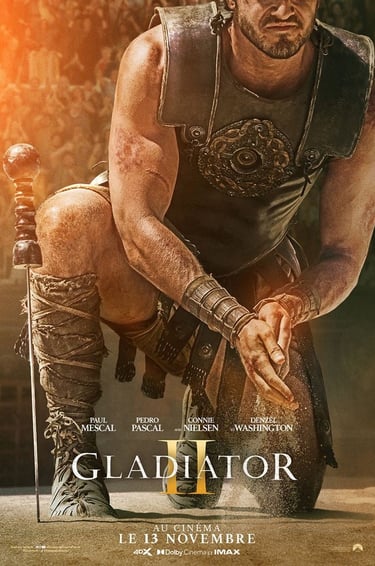




Copyright Paramount Pictures Germany
Copyright Paramount Pictures Germany
S'inscrire à notre newsletter


