Babygirl : Pas de chair, tue la chair
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Thomas Lignereux Ocana
1/19/20253 min read
2025 est à peine entamée, peut-être serait-il temps de prendre de bonnes résolutions ? On arrête les grivoiseries, futilités et bassesses propres aux saltimbanques et bas de plafond: l'adultère, pas de ça chez nous.
Du moins, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Après tout, il serait fâcheux pour vous et votre entourage d'apprendre que du haut de vos 57 ans, vous êtes la libidineuse babygirl d'un jeune premier de la classe manipulateur, tout droit sorti des plus dignes publicités d'Hermès.
Il semble en effet primordial de noter que c'est un film sur la chair, sur la sensualité que peut renvoyer cette dernière et par conséquent sur le(s) désir(s). Le film s'ouvre et se clôt par une scène de sexe. On ne peut pas faire plus démonstratif. Maintenant, saupoudrons-le d'une fine couche de fausse subversion et on obtient, ni plus ni moins, du moins à peine plus, un résultat honorant la trilogie 50 nuances. L'axe emprunté pour traiter de la sexualité battant de l'aile d'une grande patronne quinquagénaire ne semble qu'être le moyen esthétique et esthétisant pour mettre en scène le glamour de cette technocratie des hauts buildings new-yorkais surplombant avec dédain leur propre ville. Cette ville d'ailleurs qui n'existe que par la vision stéréotypée que l'on a tous d'elle; des tours de verre chics, où se dessinent en son sein, ça et là, des penthouses impersonnelles et hors de prix ou bien des bureaux de firmes inutiles aux dividendes bien trop importantes. Tout est décor, rien ne subsiste.
La matière charnelle en est la principale victime. Il est intéressant de voir les altérités du corps, comment un corps de femme, désormais plus désirable d'après les carcans sociétaux machistes, réussit à entrer en osmose avec un beau, grand et vigoureux corps de jeune homme dans la fleur de l'âge. Dans Babygirl, les corps n'existent pas vraiment non plus, ils sont filmés, bien sûr, mais jamais sans grande attention. En démontrent toutes les scènes de sexe. Jamais un organe génital ne sera entraperçu, jamais la sexualité ne sera véritablement éprouvée. Sans forcément entrer dans le démonstratif ou l'obscénité, la cinéaste peine tant à saisir l'intimité, à capturer la matérialité d'une peau, de leur rencontre, que l'acte sexuel ou sensuel se résume à de simples grimaces orgasmiques.
Cette mouvance là d'embrasser un sujet pour finalement le contourner sagement semble étonnement attester de la propension du cinéma américain à traîner les stigmates d'un code Hays abolis depuis 60 ans. Lorsque Sean Baker traite la sexualité, il la filme, et surtout il s'y intéresse, ici elle n'est que flou, gémissements et autres détours qui ne permettent pas pour autant au film d'entrer dans une sphère «tout public».
Et si l'on en vient à arguer que le film est bien plus que cela, qu'il est véritablement profond dans son propos féministe, c'est évidemment faux. Du moins, il n'est jamais que la représentation d'un féminisme de surface, un féminisme bourgeois où l'élévation entrepreneuriale importe plus que tout, en dépit même de l'éthique. L'écriture du personnage d'Esme, afro-américaine, sûrement électrice de Kamala Harris, est assez révélatrice en cela. En tant que victime contemporaine et historique d'un État au racisme systémique, couplée qui plus est à son statut de femme, elle n'est jamais là que pour asséner un message grossier, au-delà du démonstratif, voire fainéant, semblant s'adresser au spectateur tel un ignare. D'autant plus que cette véracité prônée à l'égard du réel est à géométrie variable; en effet, les femmes ne sont toujours pas assez considérées dans le monde du travail, mais il n'est à absolument aucun moment question de sa couleur de peau. De ce fait le propos bourgeois et hors-sol n'invoque jamais, ni même ne tente d'évoquer les injonctions sociales oppressant ces femmes doublement discriminées.
Le film tente finalement de distiller un propos qu'il ne s'approprie jamais parce qu'illusoire et superficiel dans sa forme, tout en tentant, non sans mal, d'instaurer une alchimie chancelante entre ses deux protagonistes.
Thomas Lignereux Ocana
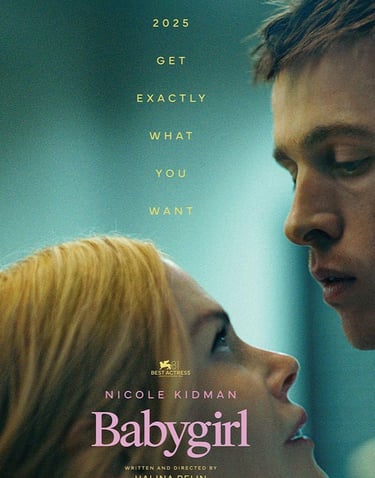
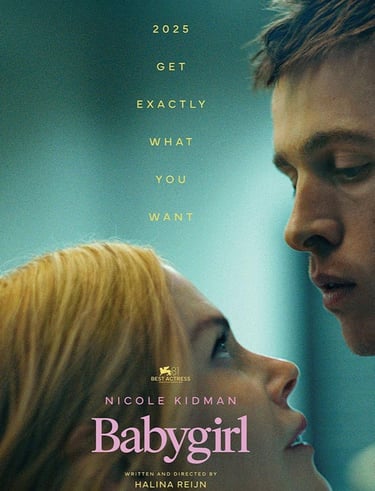




S'inscrire à notre newsletter


