Critique : Anora ou le chaos d'un rêve désenchanté
CRITIQUE NOUVEAUTÉS
Yanko Nikitine-Didi
11/11/20243 min read
Remporter la Palme d’or est une consécration rare. Avec Anora, Sean Baker signe un film aussi dense qu’incisif, où l’illusion du rêve américain s’effrite, laissant place à une absurde dystopie. Habitué à filmer les marginaux de la société américaine, Baker met cette fois en scène une escorte qui rêve d’ascension sociale et d’émancipation. Anora, en quête d'une vie meilleure, croise Ivan, le fils d’une famille d’oligarques russes. Cette improbable rencontre va peindre les rouages d’une Amérique où l’espoir de transcender sa classe est illusoire.
Après Tangerine et Red Rocket, Sean Baker poursuit sa réflexion sur le rêve américain. Anora et Ivan incarnent deux Amériques : l’une rêvant d’un déplacement social, l’autre cramponnée à ses privilèges. Si Baker se concentre sur le quotidien souvent tragi-comique des laissés-pour-comptes, c’est pour montrer à quel point l’espoir de transcender sa condition sociale s’avère vain. La rencontre entre Anora et Ivan n’est alors qu’un idylle temporaire, dans le déni de son éphémérité. Le rêve mène à la perte. Mais parfois, il est bien de rêver.
En confrontant Anora, qui assume librement sa sexualité, et la famille d’Ivan, puritaine jusqu’à la caricature, Baker trace une ligne entre deux visions du corps féminin : libre mais exploité ; méprisé et réprimé. Ici, la tension entre Eros (le désir, la pulsion de vie) et Thanatos (l’interdit, la pulsion de mort) devient essentielle. La liberté d’Anora fascine et surprend à la fois. Vitalité d’un corps qui ébranle l’homme, ployant sous ses désirs pour l’un, ou pour son immonde volonté d’assujettir la femme pour l’autre. Ainsi, Baker n’évite pas le male gaze, au contraire, il nous confronte de force à celui-ci, à la violence du désir brut et omniprésent. Regard qui emprisonne Anora dans une certaine image, rappelant le malaise de The Florida Project, où les femmes naviguaient déjà entre contrôle et liberté, entre désir et rejet. Le spectateur lui-même ressent alors viscéralement le poids qu’Anora et que les femmes en général portent : un trop-plein de restrictions, d’attentes, de projections en tout genre, jusqu’à la suffocation.
Le film se structure en deux grosses parties. D’abord un monde obsédé par la performance, où la femme est sans cesse observée, désirée, jugée… Puis, dans la deuxième partie, une chasse aux sorcière grotesque et burlesque, où la bande absurde composée d’Anora et des gardes russes est comme un microcosme qui renvoie au monde contemporain. Un monde défini comme anomique, dans l’impossibilité de communiquer. Parasité par un surplus de stimulis visuels et sonores jusqu’à la saturation, les personnages nous renvoient à une ère des images et de l’information brassée en continue, de partout. Leur quête de l’introuvable illustre celle de vies dont le sens incertain se dilue tristement avec un cachet d’aspirine. Pourtant, le film heurte, brusque, mais trouve sa dimension auteuriste dans ses ralentissements : un moyen de prendre conscience du monde qui nous entoure.
Anora est un tourbillon : le rire se mêle à la frustration, l’absurde laisse place à la compassion, et le malaise est omniprésent. Baker pousse chaque idée jusqu’au bout, quitte à déstabiliser, à nous confronter à des sentiments contradictoires. Le film frappe là où ça fait mal, fait de son spectateur le témoin averti d’un chaos profondément humain mais symptomatique d’une génération obsédée par la dopamine, où les hommes ne pensent qu’à assouvir leurs pulsions, où les femmes sont les seules à même de s’entraider, et où les miséreux aspirent à mieux. En accouche un film qui questionne l’obsession du rêve américain mais surtout notre époque, désorientée, incertaine, et bien trop misogyne.
Yanko Nikitine-Didi
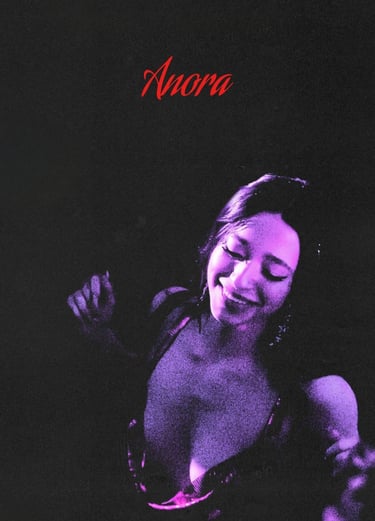
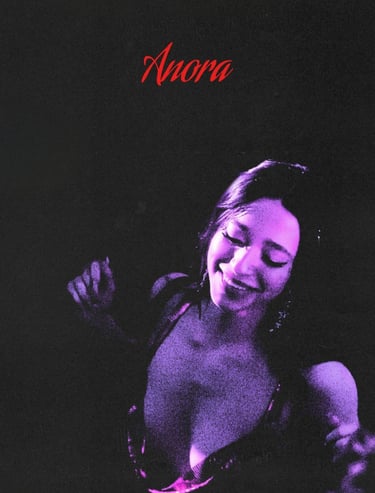




Copyright 2024 Anora Productions, LLC
Copyright 2024 Anora Productions, LLC
S'inscrire à notre newsletter


